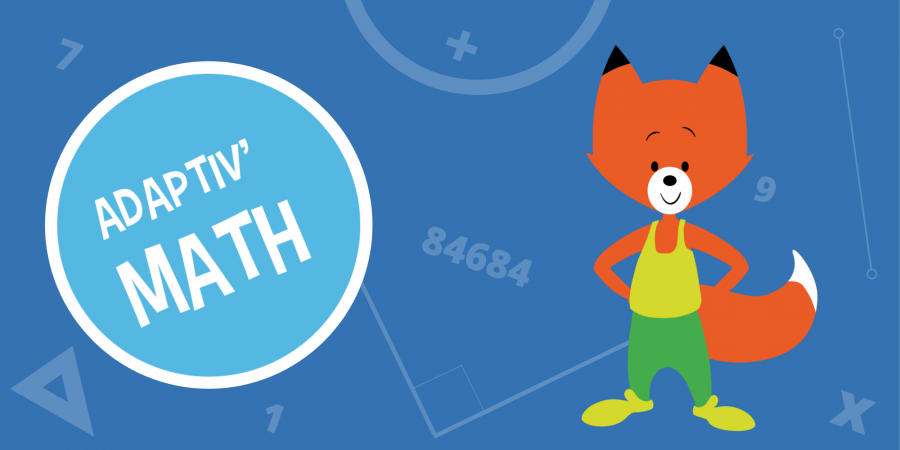Afin de garantir la mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le DPO (Data Protection Officer) fait son entrée dans les organisations. Ayant une fonction pivot, la qualité de sa formation garantira la bonne mise en conformité de l’entreprise avec la loi. Toutefois, la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs aux enjeux du RGPD sera indispensable pour lui permettre de mener à bien ses missions.
Instaurer une culture de la donnée au sein de l’entreprise
Tout d’abord, il est important de rappeler que l’emploi d’un DPO est obligatoire dans 3 cas de figure : lorsque le traitement des données est effectué par une autorité publique, au sein des organismes privés traitant des informations faisant l’objet d’un suivi régulier et à grande échelle, ainsi que chez ceux qui gèrent des données sensibles.
S’il n’existe pas de profil type pour ce poste, le DPO devra néanmoins posséder de bonnes connaissances juridiques et techniques. Surtout, ses qualités premières seront ses capacités à communiquer et à savoir faire preuve de diplomatie. En tant que superviseur de la bonne gouvernance du RGPD au sein de l’organisme, il est en effet soumis à d’importants enjeux stratégiques. Le présenter comme le successeur du CIL (Correspondant Informatique et Libertés) est donc beaucoup trop réducteur, même si ce dernier pourra être amené, dans le cadre d’une évolution de ses compétences, à occuper cette fonction.
La formation du DPO intègrera donc nécessairement toutes les dimensions de ce nouveau métier. Quant à ceux qui lui rendront directement compte au sein de l’entreprise (référents RGDP, top managers…), ils devront également faire l’objet d’un accompagnement spécifique. En s’assurant que les enjeux autour du nouveau règlement sont bien compris de tous et en instaurant une véritable culture de la donnée, l’entreprise permet à son DPO de mener à bien ses missions.
Formation certifiée : une assurance pour l’entreprise
Pour cadrer cette nouvelle fonction, au carrefour entre divers domaines de compétences et dimensions stratégiques, les offres de formation se multiplient. Mais, force est de constater que toutes ne se valent pas ! Au moment de faire son choix, l’entreprise n’a pourtant pas le droit à l’erreur. Si son DPO ne prend pas la pleine mesure de sa mission, c’est toute sa politique de protection des données personnelles qui risque d’être compromise. Et le prix à payer peut se révéler très élevé : entre 20 et 30 millions d’euros d’amende et jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires mondial.
Heureusement, il existe aujourd’hui une certification établie par Bureau Veritas, en partenariat avec l’UDPO (Union française des DPO), qui garantit la qualité des formations DPO dispensées au sein d’organismes accrédités. Celle-ci donne droit également à l’obtention d’une carte professionnelle, véritable assurance pour le futur employeur. Charge ensuite à l’entreprise d’engager son DPO dans une démarche de formation continue, rendue elle aussi obligatoire par le RGPD.
Mise en place d'un dispositif d'alerte interne
Complément indispensable du code de conduite, le dispositif d’alerte interne permet de faire remonter les informations sur des manquements potentiels. L’entreprise a l’obligation de mettre en œuvre un canal sécurisé pour le recueil des signalements émanant des employés ou de collaborateurs extérieurs. Cette procédure doit garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées. Le traitement de chaque alerte doit être diligent et impartial, mené par des personnes compétentes et formées. Ce système est un outil de détection précieux, qui permet à l’entreprise d’identifier et de traiter les risques de non-conformité avant qu’ils ne se transforment en crise judiciaire ou réputationnelle.
Procédure d'évaluation des clients et fournisseurs
Le risque de corruption ne provient pas uniquement de l’interne. Il est souvent lié aux interactions avec des tiers. La loi Sapin 2 impose donc une procédure d’évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires au regard de la cartographie des risques. Cette démarche, souvent appelée “due diligence”, implique l’évaluation de l’intégrité des partenaires commerciaux avant d’entrer en relation d’affaires et tout au long de celle-ci. L’objectif est de vérifier leur réputation, leur probité et de s’assurer qu’ils présentent des garanties suffisantes en matière de lutte contre la corruption, réduisant ainsi l’exposition de l’entreprise à des risques externes.
Instauration de contrôles comptables et financiers
La transparence financière est un rempart contre la corruption. La loi exige la mise en place de contrôles comptables, tant internes qu’externes, visant à s’assurer que les livres comptables ne dissimulent pas des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces procédures peuvent inclure des mécanismes de double validation des paiements, des audits spécifiques sur les transactions les plus exposées, ou encore des contrôles renforcés sur les notes de frais et les contrats de mécénat. Un système de contrôle robuste et documenté permet de garantir la traçabilité des flux financiers et de décourager toute tentative de dissimulation d’opérations illicites.
Déploiement d'un programme de formation des collaborateurs
Un dispositif anticorruption, aussi sophistiqué soit-il, n’est efficace que si les équipes y sont sensibilisées et formées. L’entreprise doit impérativement déployer un programme de formation destiné à former les cadres et les personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence. Cette démarche pédagogique doit leur permettre de comprendre les enjeux de la loi, de maîtriser le contenu du code de conduite et d’adopter les bons réflexes face à une situation à risque. Pour répondre à cette obligation, il est crucial de s’appuyer sur un parcours de formation sur la lutte contre la corruption qui soit à la fois engageant et adapté aux réalités opérationnelles de chaque métier. L’apprentissage par l’expérience est souvent la méthode la plus percutante pour ancrer durablement les bonnes pratiques.
Mise en œuvre d'un régime de sanctions disciplinaires
Pour assurer la crédibilité et le respect du code de conduite, l’entreprise doit prévoir et formaliser un régime disciplinaire en cas de violation avérée de ses règles. Ce dispositif doit être proportionné à la gravité des manquements et s’inscrire dans le respect du droit du travail. La communication claire sur l’existence de ces sanctions a un effet dissuasif et renforce le message selon lequel aucun écart à la politique d’éthique de l’entreprise ne sera toléré. Il en va de la cohérence de l’ensemble du programme de conformité et de l’autorité du dirigeant qui le porte.
Dispositif de suivi et d'évaluation des mesures
La conformité n’est pas un projet ponctuel, mais un processus d’amélioration continue. La dernière obligation consiste à instaurer un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en place. Ce suivi permet de s’assurer de l’efficacité et de l’adéquation du programme anticorruption au fil du temps. Il s’agit de mettre en place le pilotage et l’amélioration continue du programme anticorruption, en réalisant des audits, en analysant les incidents et en mettant à jour la cartographie des risques en fonction de l’évolution des activités de l’entreprise et de son environnement. Ce rapport de suivi est un élément clé pour la direction et pour l’AFA en cas de contrôle.
Guide pratique pour l'application de la loi Sapin 2 en entreprise
La mise en conformité avec la loi Sapin 2 peut sembler complexe, mais une approche méthodique permet de la transformer en un véritable projet d’entreprise, porteur de valeur et de sens. La première étape, et la plus fondamentale, est l’engagement sans faille de la direction générale. Le dirigeant doit incarner cette politique de tolérance zéro envers la corruption. Cet engagement ne doit pas être que de façade ; il doit se manifester par l’allocation de ressources suffisantes, par une communication claire et régulière, et par une implication personnelle dans le pilotage du dispositif. Sans ce portage au plus haut niveau, toute initiative de conformité est vouée à rester une simple formalité administrative sans impact réel sur la culture de l’entreprise.
Une fois le sponsoring de la direction acquis, le travail de fond commence par réaliser une cartographie des risques sur mesure. Cet exercice est le socle sur lequel reposera l’ensemble du programme anticorruption. Il consiste à identifier, analyser et hiérarchiser les risques de corruption auxquels l’entreprise est exposée en raison de ses secteurs d’activité, de ses implantations géographiques, ou de ses processus internes. Une analyse fine des interactions avec les tiers, notamment les intermédiaires commerciaux ou les fournisseurs stratégiques dans des zones à risque, est particulièrement cruciale. Ce document n’est pas statique ; il doit être réévalué périodiquement pour refléter l’évolution de l’entreprise et de son environnement.
Sur la base de cette analyse, l’entreprise peut ensuite décliner les mesures de manière proportionnée aux risques identifiés. L’AFA insiste sur cette approche pragmatique : les efforts de prévention et de contrôle doivent être concentrés là où les risques sont les plus élevés. Par exemple, les procédures d’évaluation des tiers seront beaucoup plus approfondies pour un consultant stratégique dans un pays jugé à risque que pour un fournisseur local de fournitures de bureau. De même, le code de conduite doit adresser, avec des exemples concrets, les dilemmes éthiques que les collaborateurs sont les plus susceptibles de rencontrer dans leurs fonctions. C’est cette adaptation qui garantit l’efficacité opérationnelle et la pertinence du dispositif.
Le déploiement du programme de conformité est indissociable d’une communication et d’une formation adaptées à chaque public. Un code de conduite ou une procédure ne sont efficaces que s’ils sont connus, compris et maîtrisés par les équipes. Il est donc essentiel de mettre en place des actions de sensibilisation qui vont au-delà de la simple diffusion de documents. Organiser une formation engageante, qui place les collaborateurs dans des situations concrètes et les aide à développer les bons réflexes, est un facteur clé de succès. Des approches innovantes, comme une formation mobile sur la lutte contre la corruption, permettent de toucher efficacement les personnels sur le terrain et de renforcer l’ancrage des messages de prévention. L’objectif est de rendre chaque collaborateur acteur de la politique d’éthique.
Enfin, l’application de la loi Sapin 2 ne s’arrête pas une fois les huit mesures déployées. Pour que le dispositif soit pérenne et efficace, l’entreprise doit instaurer une culture de l’amélioration continue. Cela passe par le suivi d’indicateurs de performance, la réalisation d’audits internes, et surtout, l’analyse des retours d’expérience, qu’il s’agisse des alertes reçues ou des difficultés rencontrées par les opérationnels. Chaque incident ou quasi-incident doit être une opportunité d’apprendre et de renforcer le système de contrôle. Ce pilotage dynamique assure que le programme de conformité reste un outil vivant, qui protège durablement l’entreprise, ses dirigeants et ses salariés face au risque de corruption.